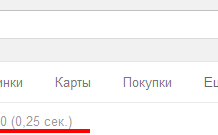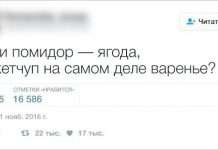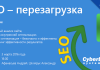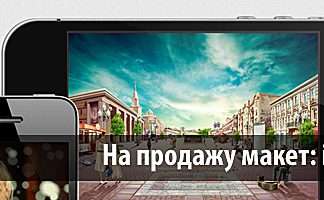Les États-Unis approchent d’un tournant critique dans leur lutte contre la rougeole, avec la possibilité de perdre leur « statut d’élimination » – une désignation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) signifiant un contrôle durable de ce virus hautement contagieux. Cela survient alors que le Canada a récemment perdu le même statut et que les épidémies continuent de se propager à travers les Amériques, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à la résurgence d’une maladie autrefois considérée comme largement éradiquée.
Les enjeux du statut d’élimination
Parvenir à l’élimination de la rougeole est une victoire majeure en matière de santé publique. Cela signifie que le virus ne circule pas librement dans un pays, protégeant ainsi les populations vulnérables – comme les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés – qui dépendent de l’immunité collective. La perte de ce statut n’est pas seulement symbolique ; cela signifie un affaiblissement des infrastructures de santé publique et un risque accru d’épidémies. Les Amériques dans leur ensemble sont parvenues à l’élimination en 2016, mais les revers au Venezuela et au Brésil démontrent à quelle vitesse les progrès peuvent s’effondrer.
Les États-Unis au bord du gouffre
Les États-Unis ont jusqu’en janvier 2026 pour reprendre le contrôle, à la suite d’une épidémie apparue dans l’ouest du Texas. En 2025, plus de 1 753 cas de rougeole ont été enregistrés dans 42 États, avec trois décès confirmés. Il est alarmant de constater que plus de 90 % de ces cas sont survenus chez des personnes non vaccinées. Cela souligne le lien direct entre la baisse des taux de vaccination et l’augmentation du nombre d’infections.
Les experts préviennent qu’une inversion du statut d’élimination serait un échec significatif. « Apparemment revenir en arrière… est très décourageant », déclare William Schaffner, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt.
Pourquoi la rougeole reste une menace
La rougeole est exceptionnellement contagieuse. Le maintien de l’élimination nécessite une immunité communautaire d’environ 95 % – soit par vaccination, soit par infection préalable. Cependant, des obstacles à la vaccination persistent, notamment l’accès géographique, les préoccupations linguistiques/culturelles et l’hésitation à la vaccination.
Les conséquences de l’infection sont graves : 1 personne non vaccinée sur 5 doit être hospitalisée, avec des risques tels que la pneumonie, la perte de vision et même des lésions neurologiques à long terme. L’épidémie de l’ouest du Texas a entraîné à elle seule plus de 700 cas et deux décès d’enfants.
La voie à suivre
Les experts s’accordent à dire que la vaccination reste la stratégie la plus efficace. Il est crucial de surmonter les obstacles à l’accès et d’instaurer la confiance au sein des communautés. Daniel Salas, épidémiologiste à l’Organisation panaméricaine de la santé, souligne la nécessité d’un « front commun » dirigé par les dirigeants communautaires travaillant avec les responsables de la santé.
Le risque ne se limite pas aux États-Unis ; tant que la rougeole persiste ailleurs, même les pays éliminés restent vulnérables aux cas et aux épidémies importés. Les cas mondiaux de rougeole attribués aux Amériques sont passés de 0,1 % en 2024 à plus de 7 % en 2025, signalant une menace croissante.
La perte imminente du statut d’élimination nous rappelle brutalement : les réalisations en matière de santé publique nécessitent une vigilance et un investissement continus. Ne pas se protéger contre la rougeole n’est pas seulement un échec de santé publique, mais aussi une tragédie évitable.